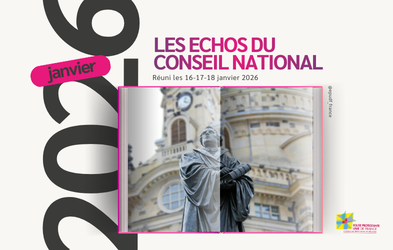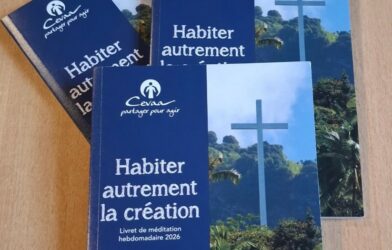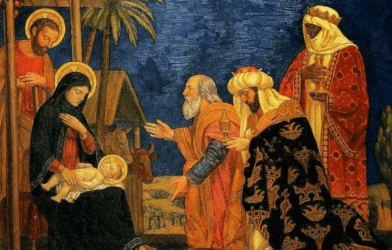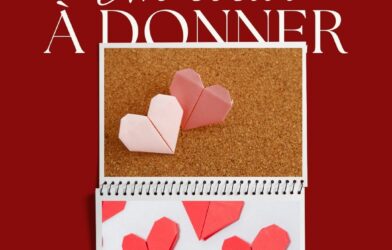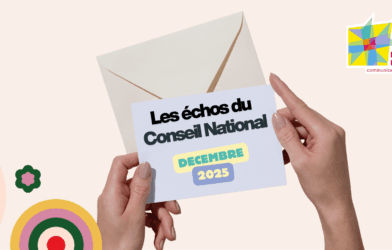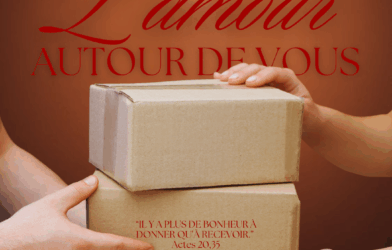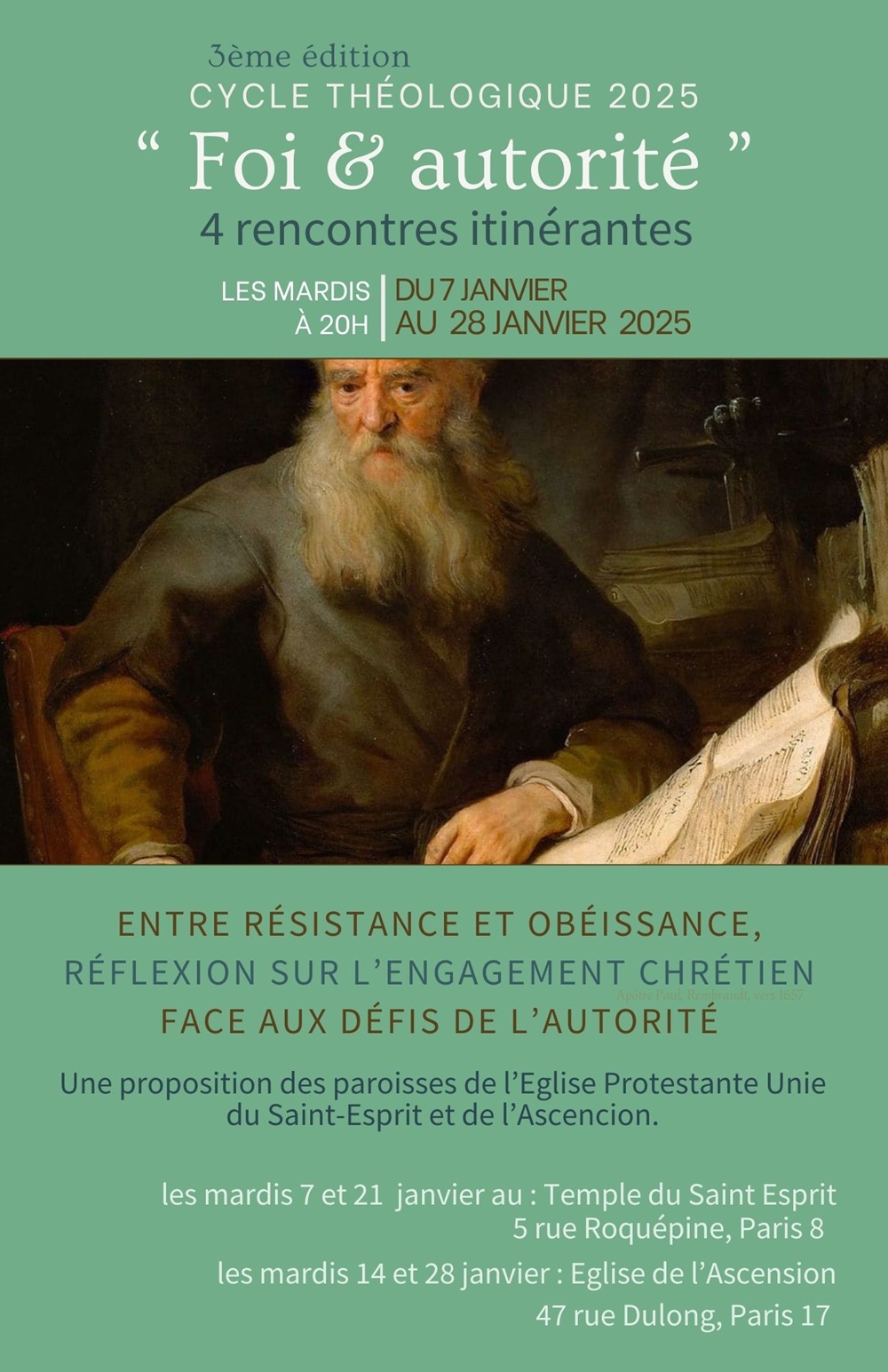
Autour du thème « foi et autorité », un large panel de ressources et de questions ont été traitées. En particulier grâce à deux invités exceptionnels : Mme Emilie Tardivel (Université de Strasbourg) et M. Philippe Büttgen (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne). Le public était au rendez-vous et un temps de questions puis d’échanges autour d’un buffet festif a permis que chacun se rencontre et partage son point de vue et ses interrogations. Un comptoir de libraire, en partenariat avec la Libraire Fontaine Haussmann, permettait à chacun de s’approvisionner en livres pour poursuivre la réflexion.
La question des rapports entre foi et autorité s’est déclinée d’abord par une enquête sur le rapport entre le chrétien et la politique, au travers des lettres de Paul et en particulier d’une prière du corpus paulinien : « exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » (1 Timothée 2, 1-2) Il était intéressant, plutôt que de chercher d’emblée une théologie de la politique chez Paul, de faire ce pas de côté en interrogeant la signification d’une telle prière.
La place accordée aux autorités par Paul en Romains 13 (Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu) n’a pas été laissé de côté pour autant. Emilie Tardivel, maître de conférence à la Faculté de Théologie catholique de Strasbourg, nous a introduit à la réception de ces versets de l’apôtre parmi les Pères de l’Eglise notamment St Justin, Tertullien et St Augustin au travers de son travail Tout pouvoir vient de Dieu, essai sur un paradoxe chrétien (2015, Ad Solem).
Mais la question des rapports entre foi et autorité ne concerne pas seulement le rapport des chrétiens à « ceux du dehors » (quelle que soit la pertinence d’une telle expression !). Le rapport à l’autorité se pose aussi dans l’Eglise et dans la vie de foi. En effet, le protestantisme s’émancipe de l’autorité de la hiérarchie ecclésiastique par l’affirmation de l’autorité de l’Ecriture. Il fallait donc penser le statut de l’Ecriture sainte. La troisième rencontre a été l’occasion d’un retour sur la doctrine classique de l’autorité de l’Ecriture (inspirée, claire et suffisante pour le salut) développée par les Réformateurs pour ensuite montrer comment l’autorité de l’Ecriture a été peu à peu, depuis les débuts de l’exégèse « historico-critique », remise en cause.
Enfin, Philippe Büttgen, Professeur de Philosphie des religions à l’Université Paris 1 Pantéhon – Sorbonne, a pu développer les recherches développées dans son dernier livre : Que m’est-il permis d’affirmer ? Philosophie des confessions (Cerf, 2024). Ce fut l’occasion de montrer l’importance des théologiens de l’Eglise Confessante d’Allemagne qui ont pensé (et employé !) la confession de foi comme force de résistance politique. Cette réflexion exigeante était d’autant plus importante pour nous Eglise « de témoins » depuis la création de l’Eglise Protestante Unie de France.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, en janvier, autour d’un autre thème : Foi et… travail !
Pasteur Timothée Gestin