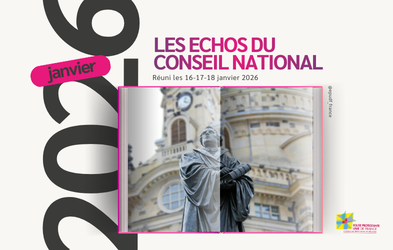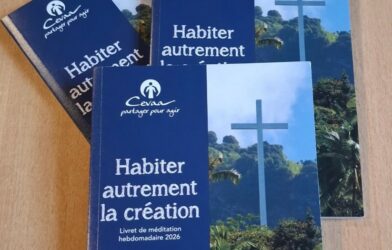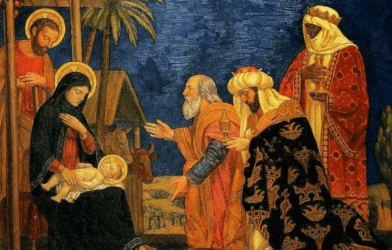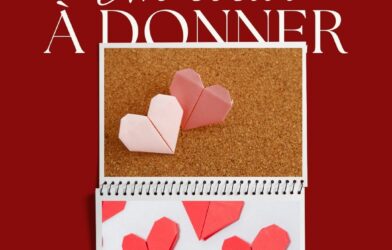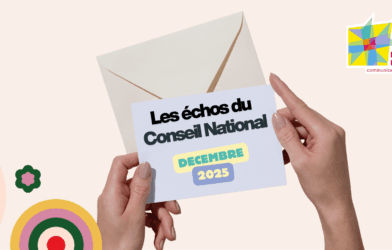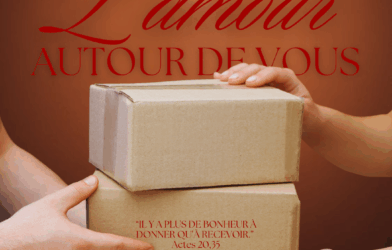Dès 1576, l’Edit de Beaulieu, mettant fin à la cinquième guerre de religion, autorise « ceux de la Religion » à bâtir des lieux de culte sauf à Paris et à moins de deux lieues de la capitale. Il s’agit également de légaliser ceux qui existent déjà comme à Lyon où le fameux temple « du Paradis » avait été édifié en 1564.
L’édit de Nantes de 1598 permet encore l’établissement de lieux de culte mais précise que, pour le cas de Paris, ils ne peuvent être à moins de cinq lieues de Notre-Dame, soit 22km. Le culte se tient donc quelques mois à Grigny chez Josias Mercier, seigneur de cette localité aujourd’hui en Essonne. Puis un des pasteurs parisiens accueille les protestants chez lui à Ablon, quelques kilomètres plus au Nord ce qui fait entrer les huguenots dans l’illégalité (il n’y a plus que 14km à parcourir !). Au bout de sept ans et beaucoup de négociations, lassés de parcourir quatre heures de marche pour aller au culte, les protestants obtiennent un édit le 1er août 1606 pour établir un temple dans le Sud-Est parisien, à Charenton. Le seigneur de Charenton est furieux : « Ce n’est pas cinq lieues de Paris », ce à quoi Henri IV aurait répondu : « Désormais, il faudra compter cinq lieues de Paris à Charenton… ».
Imaginez donc cette cohorte de protestants parisiens marchant le long de la Seine ou par petits groupes dans des embarcations sur le fleuve, allant ensemble tutoyer Dieu en priant en français et chantant les Psaumes à tue-tête en chemin… De quoi nourrir bien des troubles !